| | | | | |
La SFD et Vous SOCIETE FRANCOPHONE DU DIABETE
Lettre d’informations N°28 Avril 2020
| | | |
|
| | |
|
| |
Spécial COVID-19
A situation exceptionnelle, SFD et Vous exceptionnel… Voici un nouveau numéro centré sur COVID-19 puisque notre vie personnelle et notre activité sont complètement bouleversées par la situation actuelle et centrées sur COVID-19. Nous avons néanmoins également fait le point sur les réunions et congrès prévus ou reportés. Bonne lecture et prenez soin de vous ! | |
|
|
|
| | Lancement de l’étude CORONADO
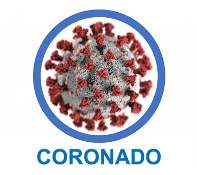
Etude CORONADO: CORONAvirus SARS-CoV2 and Diabetes Outcomes
L’infection COVID-19 (Coronavirus Disease-2019) est une pandémie causée par le coronavirus SARS-CoV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) apparue en Décembre 2019 dans la région de Wuhan et qui depuis touche plus de 150 pays à travers le monde et notamment la France. Les premières données épidémiologiques, majoritairement issues d’études chinoises, indiquent que le diabète est l’une des comorbidités les plus fréquemment observées, avec l’hypertension artérielle, chez les patients atteints de COVID-19. Surtout, la présence d’un diabète à l’admission serait un facteur pronostique pour le risque à la fois d’hospitalisation en soins intensifs et de décès.Néanmoins, les données spécifiques de la maladie diabétique (type de diabète, durée d’évolution, présence de complications) chez les patients souffrant de COVID-19 demeurent imprécises et parcellaires, justifiant la réalisation d’une étude observationnelle dédiée.
L’étude nationale CORONADO a pour objectif de décrire précisément les caractéristiques phénotypiques des patients diabétiques admis à l’hôpital pour la prise en charge d’une infection COVID-19. Une attention particulière sera notamment portée à la qualité de l’équilibre glycémique à l’admission (i.e. le niveau d’HbA1C), ainsi qu’à la présence des complications du diabète et aux traitements anti-diabétiques et anti-hypertenseurs. Cette étude permettra d’apporter très rapidement des réponses aux soignants et aux patients diabétiques quant aux facteurs de risque d’infection COVID-19. A terme, cette étude pilote doit également servir de base à l’élaboration de nouvelles études dans le domaine et à l’établissement de recommandations pour la prise en charge des patients diabétiques atteints de COVID-19.
Sur le plan réglementaire, il s’agit d’une étude observationnelle rétrospective et prospective hors loi Jardé. Par mesure exceptionnelle, il a été demandé à la CNIL une dérogation à l'obligation d'information individuelle et au recueil systématique de la non-opposition des patients, dans le contexte spécifique d'urgence sanitaire lié à l'épidémie COVID-19. Le recueil de données se fera à partir des dossiers hospitaliers informatisés et devra être complété si besoin par contact téléphonique avec les médecins généralistes/diabétologues assurant le suivi des patients et/ou leur laboratoire d’analyse biologique habituel.
Cette étude est promue par le CHU de Nantes et coordonnée par le Pr. Bertrand CARIOU. Elle bénéficie du soutien de la SFD (Société Francophone du Diabète), de la SPILF (Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française) et de la FFD (Fédération Française des diabétiques).Cette étude se déroule sur le territoire français, métropole et outre-mer, dans 58 centres rassemblant des centres hospitaliers de toutes tailles.CORONADO, c’est également un élan national, tels qu’en témoignent l’enthousiasme et la mobilisation extrêmement rapide des centres de diabétologie. C’est aussi la mobilisation du CHU de Nantes et la réactivité de sa DRCI et de ses personnels, tous unis dans une vague de solidarité. C’est enfin notre engagement auprès de nos patients qui permettra de faire progresser leur prise en charge.
| | | |
|
|
|
| | Du côté des associations professionnelles et des congrès | |
|
|
|
| | Du côté des e-diabete masterclasses | |
|
|
|
| | Il s’agit d’une formation à distance, par des experts, sur la thématique du diabète, en partenariat notamment avec la SFD. Ces cours mensuels, initialement conçus essentiellement pour les personnes exerçant dans des pays francophones situés loin des lieux des congrès, sont en fait destinés à tous. Ils sont diffusés le jeudi (13h00 GMT = 14h00, heure de Paris) et si vous vous êtes inscrit au préalable, vous pourrez poser des questions en direct à l’expert. Ces cours restent ensuite disponibles sur le site par le lien ci-dessous. Le cours du mois de mars a été donné par le Pr Gérard REACH (Décision médicale partagée), celui d’avril sera donné le jeudi 16 avril par le Dr Guy FAGHERAZZI (Big data et intelligence artificielle : en route vers l’épidémiologie moderne du diabète). L’affiche vous sera communiquée dès que possible sur Twitter (@SFDiabete). Pensez à vous inscrire pour pouvoir poser vos questions en direct !
• https://masterclasse.e-diabete.org/site/ | |
|
|
|
| | Nous allons essayer de répondre à 3 questions que vous vous posez et/ou que les patients vous posent et dans ce numéro : - Pourquoi le confinement est-il la seule solution pour limiter la tragédie ?
- Qu’est-ce qui explique la gravité de COVID-19 : quels sont les mécanismes entrainant éventuellement le décès dans les formes graves ?
- Que penser de l’utilisation de l’hydroxychloroquine ?
Pourquoi le confinement actuel est-il la seule solution pour limiter la tragédie ?
Les statistiques officielles annoncent au soir du 30 mars 2020 presque 45.000 cas confirmés de COVID-19 et plus de 3000 décès en France alors que nous ne sommes qu’au début de l’épidémie et que globalement, seuls les patients hospitalisés sont comptabilisés. Vous trouverez des statistiques quotidiennes pour la France établies à partir des données officielles dans les liens ci-dessous. Vous verrez également les courbes établies par le Financial Times intégrant la date de confinement des différents pays : la France a établi le confinement lorsque le nombre de décès était à 175, l’Espagne à 200, l’Italie à 800. Surtout, vous verrez les courbes de chaque pays, comparées à celle de l’Italie avec l’évolution très inquiétante du Royaume-Uni (UK) et des États-Unis (USA). Il faut lire l’article très intéressant de l’équipe de l’Imperial College de Londres reprenant les différents scénarios pour l’UK et les USA : les épidémiologistes estiment qu’en l’absence de toute mesure, 81% de la population serait atteinte si l’on admet un R0 (nombre de personnes contaminées par 1 individu infecté) à 2,4, le pic épidémique se produirait à 3 mois (en mai-juin). Le nombre absolu de décès serait d’au moins 510.000 en UK, 2,2 millions aux USA. Pour limiter la tragédie, 2 scénarios sont possibles : atténuation ou suppression de l’épidémie. La stratégie d’atténuation de l’épidémie vise à aplanir la courbe (terminologie que l’on connaît bien) mais en laissant l’immunité se développer (stratégie anglaise initiale). Elle vise à diminuer R0 mais sans chercher à l’amener à moins de 1. Le confinement doit alors être mis en place ni trop tôt (risque de résurgence à la levée) ni trop tard (risque d’échappement). La combinaison la plus efficace est une association d’isolement des cas atteints qui se mettraient en quarantaine volontaire avec toutes les personnes vivant dans le même foyer et de distance sociale pour les personnes à risque élevé de forme grave. L’effet attendu est une réduction des hospitalisations en réanimation des 2/3 au moment du pic et de la mortalité de 50%. Cette stratégie ne peut pas éviter la saturation des services de soins intensifs qui seraient sollicités à plus de 8 fois les capacités réelles en UK et aux USA. La seule stratégie possible doit donc être une stratégie de suppression de l’infection destinée à ramener R0 à 1 voire même à moins de 1. Ceci correspond à ce que nous vivons en France avec les mesures que vous connaissez. Le temps nécessaire pour que ces mesures soient efficaces est de 3 semaines et les mesures doivent être maintenues suffisamment longtemps – en théorie « plusieurs mois » - pour être efficaces. Le risque de pic secondaire est ensuite important. Mais, pour rester optimiste, il faut se dire que pendant le confinement des stratégies sont développées pour se protéger (fabrication et livraison de masques…) pour tester les sujets (PCR) et identifier ceux qui sont immunisés (sérologie) et pour trouver un traitement et/ou un vaccin en sachant que le temps estimé pour disposer de celui-ci est de 18 mois d’après les experts.
• https://www.eficiens.com/coronavirus-statistiques/#evolution-contamination-france • https://www.ft.com/coronavirus-latest • https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
Qu’est-ce qui fait la gravité de COVID-19 ?
L’étude des déterminants des formes graves de COVID-19 chez les personnes ayant un diabète est l’objectif principal de l’étude CORONADO (Cf. Édito). Il faut noter cependant que la mortalité peut survenir chez des personnes jeunes sans aucune comorbidité comme l’actualité nous l’a malheureusement montré très récemment. Il faut ainsi noter que la moitié des personnes hospitalisées en réanimation en France pour COVID-19 a moins de 58 ans.
- Caractéristiques des patients en réanimation : Dans la série Chinoise initiale de 710 patients ayant une pneumonie liée à COVID-19, 52 patients ont été admis en réanimation : âge moyen 59,7 ans, 67% hommes, 40% avec comorbidité, 37 (71%) ont nécessité une ventilation assistée et 32 (61,5%) n’ont pas survécu. Vous retrouverez davantage de chiffres dans le numéro spécial de SFD et Vous de mi-mars (lien ci-dessous).
- La charge virale : Il semble que la gravité soit dépendante de la charge virale. Ce serait la raison pour laquelle le personnel soignant paye un si lourd tribu dans cette épidémie notamment en réanimation où les soignants sont contaminés par des patients à forme grave donc à charge virale très élevée. Le virus est excrété pendant une durée médiane de 20 jours mais pouvant aller jusqu’à 37 jours. La contagiosité existe 2,5 jours avant les symptômes pour être maximale 0,6 jours avant les symptômes. Les sujets âgés ont apparemment une charge virale plus élevée, attribuée à une immuno-senescence et qui pourrait expliquer la fréquence plus élevée de cas sévères. En revanche, la présence d’une comorbidité (comme le diabète) ne semble pas augmenter la charge virale.
- SDRA sévère : dans certains cas, survient un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) qui ne répond pas à l’oxygénothérapie à haut débit ou à la CPAP ou même à la ventilation assistée avec mise en décubitus ventral. Un recours à l’ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) veino-veineuse (ou veino-artérielle en cas de défaillance cardiaque) dans un service ultra-spécialisé peut alors devenir nécessaire.
- Myocardite virale : Il s’agit d’un événement fréquent chez les patients avec COVID-19 sévère : presque 20% dans l’étude de Wuhan publiée dans le JAMA. Les patients ayant une myocardite présentaient souvent des douleurs thoraciques (13,4% versus 0,9% des cas sévères sans myocardite), avaient plus souvent un diabète (24,4% vs 12,0%), une troponine élevée, une pneumonie bilatérale (91,5% versus 70,7%) et une issue fatale (51,2% versus 4,5%). L’ECG est alors toujours anormal évoquant une nécrose myocardique. Donc attention aux douleurs thoraciques qui ne sont pas forcément à relier à la pneumopathie.
- Embolie pulmonaire (EP) : Le risque d’EP est augmenté dans COVID-19. Il est difficile de savoir si les anomalies de coagulation sont spécifiques ou si elles sont liées au syndrome inflammatoire. Des D-dimères élevés doivent amener à réaliser une imagerie (angioscanner pulmonaire). Dans la série Chinoise, la mortalité associée était de 20%.
- « Orage cytokinique » : Cette « tempête » entraine une défaillance multiviscérale comme on peut en voir dans d’autres affections virales. C’est apparemment la cause la plus fréquente de mortalité après le SDRA et cela touche plutôt des sujets jeunes. Il existe une augmentation nette des cytokines. Les facteurs prédisant le décès seraient la ferritine élevée (1297 ng/ml chez les sujets décédés versus 614 chez les survivants) et l’IL-6, suggérant que la mortalité pourrait être liée à une « hyper-inflammation ».
• https://www.sfdiabete.org/actualites/medical-paramedical/covid-19-et-diabete-etat-des-lieux • https://www.cebm.net/covid-19/sars-cov-2-viral-load-and-the-severity-of-covid-19/ • https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30079-5/fulltext • https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30196-1/fulltext • https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30127-2/fulltext • https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2763524 • https://sfar.org/download/the-lancet-infectious-diseases-findings-of-acute-pulmonary-embolism-in-covid-19-patients/?wpdmdl=25489&refresh=5e80c584eeab61585497476 • https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30628-0/fulltext • https://www.college-de-france.fr/media/philippe-sansonetti/UPL1414529259917354829_Covid_19_Sansonetti.pdf
Que penser de l’utilisation de l’hydroxychloroquine (HCQ) ?
Sans rentrer dans la polémique, il est important de rappeler plusieurs faits :
- Les études sur lesquelles s’appuient les arguments pour utiliser l’HCQ (une sur 42 patients, une sur 80 patients) sont des études non randomisées. - Dans la première étude, parmi 26 patients qui ont reçu de l’HCQ (200 mg x3/j ce qui représente une forte dose), 3 ont été transférés en réanimation, 1 est décédé (sa charge virale s’était négativée la veille), 1 a stoppé en raison d’effets secondaires, l’autre sans raison rapportée. Ces 6 patients (= 23% des patients traités) ont été considérées comme « perdus de vue » et exclus des analyses… Seuls 30% des patients recevant l’HCQ avaient une pneumonie (70% étaient asymptomatiques ou avec une infection des voies aériennes supérieures). - En revanche, parmi les 16 qui n’ont pas reçu l’HCQ (= contrôles qui ont refusé le protocole), aucun n’a eu d’évolution défavorable. Il faut signaler dans ce groupe la présence de 2 enfants de 10 ans, un de 12 ans (alors que les critères d’inclusion stipulaient >12 ans). - L’étude en pré-publication sur 80 patients traités (dont 6 patients de la 1ère étude) conserve globalement les mêmes principes sans groupe contrôle, 53% des patients seulement ayant une pneumonie, 4 étaient asymptomatiques. - Une étude chinoise randomisée sur 30 patients utilisant l’HCQ (200 mg x2/j) est négative sur des critères cliniques, radiologiques et de charge virale, ne montrant pas d’effet significatif de l’HCQ. - La chloroquine qui inhibe la réplication du Chikungunya in vitro a un effet paradoxal in vivo en augmentant les signes infectieux chez l’animal et en retardant la réponse immunitaire chez l’homme : les effets d’un traitement ne peuvent se limiter à ses effets sur la charge virale. - Les doses d’HCQ utilisées sont des doses élevées. Le risque d’augmentation de l’espace QT augmente avec la dose. L’azithromycine associée augmente également l’espace QT. Le risque de torsade de pointe est donc non négligeable surtout en présence d’une hypokaliémie (fréquente dans COVID-19, parfois <3,0 mmol/L) et a même été rapporté avec arrêt cardiaque (non publié). De plus les myocardites sont fréquentes dans COVID-19 et augmentent encore le risque de QT long. Un ECG est impératif avant la mise en route du traitement, dans les 3-4 heures qui suivent puis 2-3 fois par semaine (Cf. lien pharmacovigilance). - Des troubles du rythme graves ayant amené certains patients en réanimation (où les places sont limitées +++) ont été rapportés chez certains patients ayant pris de l’HCQ en dehors de tout essai clinique et sont en cours d’analyse, ce qui a amené l’ANSM à lancer un message d’alerte (lien ci-dessous). - Il est donc impératif d’attendre des essais randomisés réalisés dans de bonnes conditions, dont on devrait avoir très rapidement les premiers résultats.
• https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300996
• https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/COVID-IHU-2-1.pdf • http://www.zjujournals.com/med/EN/10.3785/j.issn.1008-9292.2020.03.03 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5977261/ • https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-demarrage-essai-clinique-discovery • https://www.rfcrpv.fr/chloroquine-point-dinformation/ • https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Plaquenil-et-Kaletra-les-traitements-testes-pour-soigner-les-patients-COVID-19-ne-doivent-etre-utilises-qu-a-l-hopital-Point-d-information
| |
|
|
|
| | | | Et n’oubliez pas de nous rejoindre sur Twitter : @SFDiabete et de consulter régulièrement les offres d’emploi diffusés sur notre site. | | | |
| | Responsable Editorial : Sylvie Picard, Dijon
Pour toute remarque ou suggestion, contactez-nous. si vous n’arrivez pas à visualiser correctement cet email, cliquez ici. | | | |
|
|
|
| | | © 2020 Société Francophone du Diabète 60 rue Saint-Lazare, 75009 Paris, France - +33 (0)1 40 09 89 07
Cet email n’est pas un spam, il vous est adressé personnellement en votre qualité de membre de la SFD. | |
|
|
|
|
|
|